Bon, d’accord, j’ai eu une commande ferme pour mon brouillon 54 — voir mon billet précédent — mais je ne vais pas l’honorer tout de suite…
Il se trouve qu’entre temps il s’est passé pas mal de choses et que le microcosme, toujours de plus en plus étonnant, s’agite à propos d’éducation au numérique.
Il n’y a guère que le microcosme qui s’agite, car, comme sœur Anne, du côté du ministère, je ne vois rien venir. Le programme des conférences qu’on annonce à Educatice — dont il serait utile de changer le nom, non ? — est désespérant, désespérément désespérant. On aurait pu voir le même il y a dix ans. Il n’y a strictement rien de neuf, à l’exception peut-être des MOOC, sur lesquels il convient encore d’être circonspects, et de la désopilante expérimentation sur les vingt (20 !) collèges numériques…
C’est tellement désespérant que je ne me suis inscrit à aucune des conférences. C’est la première fois que ça m’arrive. J’irai quand même, bien sûr, histoire de rencontrer les ami(e)s et de boire une bière ou deux avec eux (elles).
Revenons à mon propos initial et liturgique.
Le code, le code, le code, le code, le code, le code !
C’est encore le programme d’Éducatice qui m’a mis la puce à l’oreille. Depuis Mathusalem, l’EPI nous propose son inusable table ronde, cette année sur le thème « L’enseignement de l’informatique en France – Il est urgent de ne plus attendre » repris du navrant rapport de l’Académie des sciences. En fait de table ronde, n’attendez aucune contradiction, il y aura là des gens qui s’entendent comme larrons en foire.
Les arguments de ces gens-là sont incroyables : le numérique est partout — c’est pourtant un mot qui leur était inconnu il y a peu — en conséquence de quoi, tenez-vous bien, il faut enseigner l’informatique qui est au cœur du numérique (sic). Ils n’ont bien sûr jamais imaginé qu’on puisse enseigner le numérique, ce n’est pas leur affaire. Et ce n’est pas leur affaire parce que, voyez-vous, eux, les informaticiens, ce sont des scientifiques, et que les scientifiques ne sauraient partager l’enseignement de quoi que ce soit avec qui que ce soit qui ne soit pas scientifique ! C’est trop noble.
C’est surtout spécieux d’un bout à l’autre. Et déplorable.
Les exemples du contraire, pourtant, ne manquent pas. J’avais déjà raconté comment, à Mines-Télécom Paris, la chaire « Valeurs et politiques des informations personnelles » faisait se rencontrer et échanger des sociologues, des économistes, des philosophes, des juristes et aussi, bien sûr, des informaticiens. En pleine harmonie.
Le numérique est comme ça, il n’est ni une science, ni une technologie, ni une philosophie, ni une économie, il est tout ça à la fois et bien d’autres choses encore. Quand on n’est pas capable de percevoir ces enjeux de la transversalité et de l’échange, consubstantiels l’une et l’autre du numérique, et qu’on tente de défendre son pré carré, on ne fait pas autre chose que d’introduire dans l’école, contre le numérique « lumières et connaissances », source de savoirs à construire, une sorte de nouvel obscurantisme moderne.
Oui, je sais, j’ai déjà utilisé ce mot qui ne me semble en effet, pas trop fort, au regard des dégâts possibles.
Tout cela n’aurait pas beaucoup d’importance et on pourrait laisser discourir en rond l’EPI et ses amis, si, récemment, tout récemment, je n’avais lu, de la part de personnes autorisées, d’autres bizarres arguments pour promouvoir l’enseignement du code « nouveau langage d’aujourd’hui » et de l’informatique.
Ainsi, Benoît Raphaël, sur son blog, cite les propos de Fleur Pellerin, la ministre en charge de l’économie numérique qui dit :
« Les jeunes aujourd’hui sont trop souvent des consommateurs passifs des outils numériques. Apprendre à coder ou à développer peut leur permettre de comprendre comment est construit l’univers digital dans lequel ils évoluent, et de développer une distance critique. ».
Je passe sur le fait qu’une ministre de la République soit incapable de s’exprimer dans un français correct et parle d’univers digital quand il s’agit de numérique.
Mais quelle illusion ! Et que d’erreurs !
Au-delà des clichés sur ce que sont les jeunes — qui les a faits consommateurs ? à supposer qu’ils le soient plus que leurs parents, ce qui est loin d’être prouvé — il y a aussi beaucoup de mépris et de pré-supposés sur leur incapacité à mettre de la distance et à exercer leur sens critique. Toutes les enquêtes récentes montrent a contrario qu’ils ont développé des compétences étonnantes dans ce domaine, même s’il y a bien sûr des exceptions. Mais le plus grave n’est pas là : les jeunes, selon la ministre, seraient passifs et pas actifs, un comble dans un pays où les adolescents envoient chacun 4 000 textos par mois, des centaines de photos dans le nuage et sont les champions du monde toutes catégories des blogues !
L’école, en prenant en charge le développement de ces nouvelles compétences liées à la publication, la confrontation de l’expression libre des élèves à celle d’un auditoire critique, contribuerait ainsi fortement au développement et à la formation du jeune citoyen, dans son temps numérique.
Alors, convient-il d’apprendre à coder et à comprendre les programmes informatiques et l’algorithmique ? Bien entendu ! Mais certainement pas de manière isolée et décorrélée de l’environnement sociétal et de l’écosystème numérique.
Benoît Raphaël, qu’on a connu mieux inspiré, en rajoute une couche, en accumulant les poncifs : « Le code est l’un des nouveaux alphabets du XXIe siècle, et aussi l’une des clés de la croissance économique de demain. »
Non, M. Raphaël, l’économie de demain a besoin certes de développeurs mais surtout de femmes et d’hommes éclairés, formés à exercer leur citoyenneté numérique, à comprendre et utiliser tous les langages, ceux des machines, pourquoi pas ?, mais surtout ceux qui leur permettent de vivre ensemble, de produire, de publier, de co-construire et de partager.
Que dirait-on d’une école qui apprendrait le code à ses élèves sans se préoccuper un seul instant des nouvelles approches, dans tous les domaines, des nouveaux modèles induits par le numérique ? Quel sens aurait l’apprentissage de l’algorithmique et du code sans l’éclairage de l’éducation aux médias, des littératies numérique, médiatique et informationnelle ? Ce serait irresponsable, rien de plus.
Fin du premier chant liturgique. Plutôt vieillot, plaintif et lancinant, vous l’avez vu.
Les usages, les usages, les usages, les usages, les usages, les usages !
Et ça continue de plus belle. Le deuxième chœur reprend le refrain…
Pendant donc que le lobby des informaticiens scientifiques manipule l’opinion avec son nouveau langage, les élites françaises de l’éducation, tous degrés confondus, n’ont que le mot « usage » à la bouche.
De fond en comble du système éducatif, chacun, quels que soient le grade et la responsabilité, se gargarise de la promotion de l’« utilisation des Tice », d’évaluer la « maîtrise de techniques usuelles » voire d’intégrer « l’outil numérique », toutes phrases qui n’ont en commun que de servir de hochet — vous savez ? ce jeu qui ne sert à rien d’autre que passer le temps — à ceux qui les prononcent et montrent à l’évidence l’inculture dans laquelle ils baignent.
Qui, parmi ces prosélytes de pacotille, a vraiment compris ce que signifiait l’émergence d’une culture numérique dans l’éducation, culture qu’il est nécessaire de conquérir car on ne se cultive pas à coups d’injonctions, fussent-elles ministérielles ?
Qui a vraiment compris à quel point les apprentissages, les postures des maîtres, la transmission des connaissances, la construction des savoirs, les relations inter-personnelles et sociétales allaient s’en trouver bouleversées et qu’il convenait au moins de s’interroger et d’anticiper ?
Qui a vraiment compris qu’avec le numérique, les mots-mêmes de groupe classe, de salle de classe, de cours, de temps de cours, de temps scolaire, d’estrade, de tableau, de bibliothèque, tous fondateurs de l’école de Jules Ferry, allaient complètement changer de sens et que le modèle ne serait nécessairement plus le même ?
Cette nouvelle liturgie des usages, dont je disais dans un billet récent qu’ils étaient rédempteurs, qui inonde la littérature sur le sujet, n’a que pour seul mérite de contenter les décideurs et les payeurs, élites et collectivités, qui savent enfin où va l’argent du contribuable électeur. Plus on voit d’usages, plus on est content, plus l’électeur est content, mais moins on s’interroge au fond sur le sens et les conséquences de ces profondes mutations.
Fin donc du deuxième chant liturgique, particulièrement peu audible.
Les écrans, les écrans, les écrans, les écrans, les écrans, les écrans !
Il est encore, là, tapi dans l’ombre, un autre chœur liturgique qui nous ressasse ses psaumes. C’est celui d’un certain nombre d’observateurs plus ou moins pertinents qui n’ont que le mot « écrans » à la bouche. Tout est écran, c’est la faute des écrans, c’est grâce aux écrans, il faut faire attention aux écrans, un écran peut en cacher un autre…
Parmi les choristes, on reconnaît quelques éminents sociologues soucieux de vulgariser leur discours parfois simpliste, des associations de toutes sortes, parents d’élèves ou d’autres encore qui vendent leur discours anxiogène à qui veut bien les entendre, des élites médiatiques encore, là, au fond à droite, la Défenseure des enfants et aussi quelques scientifiques échappés de l’Académie éponyme déjà repérés et distingués dans le premier chœur.
J’ai, là encore, dans un billet vieux d’un an, montré comme l’abus de langage, la répétition presque lancinante de la synecdoque, aboutissaient à ne pas se poser la question du fond, là encore, et de la nature et de la pertinence des messages médiatiques qui traversaient ces écrans, des informations qui étaient transportées, de la manière dont elles étaient reçues et dont se mettaient en place les interactions et les relations sociales… Ce qui est important, ce n’est pas le chas de l’aiguille, mais l’ouvrage qui résultera du travail de cette dernière.
Fin du troisième chant liturgique, opaque, en forme d’écran — justement ! — de fumée…
Les ressources, les ressources, les ressources, les ressources, les ressources, les ressources !
La cérémonie n’est jamais complète s’il n’y a pas quelque part un quatrième chœur, celui-là particulièrement fourni et virulent. Il exerce, lui aussi, un lobbying actif pour avoir la prééminence et obtenir raison.
Pour ses membres, particulièrement influents, qu’il faut chercher parmi les éditeurs publics et privés, leur réseau éducatif ou commercial et tous les aficionados et autres séides qu’ils ont su séduire, il n’est de bon usage — ce chœur a des liens intimes avec le deuxième — du numérique qu’accompagné de ressources dont j’ai dit, dans mon dernier billet, qu’elles constituaient, pour eux, nécessairement, un corpus cohérent, validé et didactisé. J’aurais aussi pu ajouter qu’il était stocké quelque part à disposition des utilisateurs qui devaient, moyennant contrepartie, disposer de droits pour en user. Remarquez le vocabulaire !.
Je m’arrête là. Le sujet mérite mieux qu’un clin d’œil. Tous ces gens-là se trompent, à mon avis, et il faut que je prenne le temps de comprendre et de vous expliquer pourquoi.
Le code, les usages, les écrans, les ressources… Les choses sont ainsi faites que le numérique éducatif avance cahin-caha, sous l’influence conjuguée de courants de pression peu enclins à partager quoi que ce soit et surtout pas à chanter ensemble.
Et juste, de préférence.
Michel Guillou @michelguillou
Crédit photo : Etolane via photopin cc
[cite]



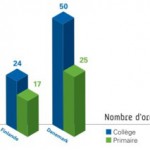













Laisser un commentaire